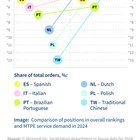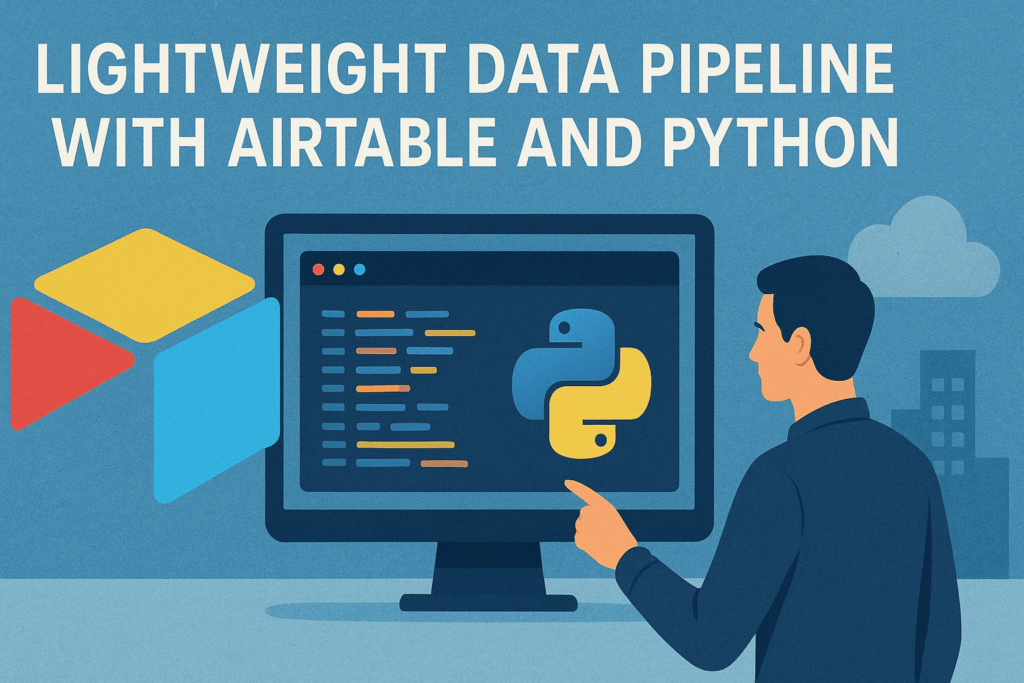Une taxonomie de résistance d’IA. Une taxonomie délimitant à la fois la bonne foi… | par Michael Foster | Mars 2025

Une taxonomie délimitant à la fois la bonne foi et les appréhensions de mauvaise foi concernant l’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus évidente, révélant des motivations implicites sous-jacentes chacune. Les préoccupations de bonne foi largement catégorisées tournent principalement autour de l’incertitude face à l’inconnu – les craintes liées à la déstabilisation économique, les questions de but existentiel humain dans une société post-laborante et d’autres transformations sociétales profondes – tandis que les appréhensions de mauvaise foi reflètent généralement des anxiétés enracinées dans la perte de la capacité d’emploi de la linguistique et des conceptions socioculturales comme des instruments pour le contrôle, la manipulation, la manipulation, le maintien et le maintien.
Peurs économiques et existentielles
La résistance de bonne foi à l’IA provient principalement des incertitudes existentielles authentiques. La peur omniprésente de l’effondrement économique résultant du chômage de masse reflète une appréhension légitime de l’adaptabilité sociétale aux perturbations dramatiques du marché du travail. Ces angoisses transcendent les problèmes d’emploi individuels pour englober des instabilités systémiques plus larges, remettant en question la viabilité économique dans des scénarios où des parties importantes de la main-d’œuvre deviennent rapidement redondantes.
Parallèlement, les préoccupations concernant l’objectif de l’humanité en l’absence d’emploi traditionnel articulent des problèmes philosophiques plus profonds liés au sens, à la dignité et à l’identité personnelle. Bien que spéculatifs, ces angoisses sont profondément enracinées dans une réflexion sérieuse sur les capacités transformatrices sans précédent de l’IA et leurs implications pour les sociétés humaines.
De plus, des questions éthiques se posent concernant la distribution équitable de la richesse et des ressources dans un monde de plus en plus dominé par les processus de production automatisés. La stratification sociétale peut s’intensifier, créant des divisions marquées entre ceux qui contrôlent les systèmes axés sur l’IA et ceux déplacés par eux, entraînant des tensions sociales profondes et une instabilité accrue.
Peurs éthiques et judiciaires
De plus, les appréhensions de bonne foi incluent les craintes liées à des conséquences imprévues, telles que les biais algorithmiques qui peuvent renforcer les préjugés sociaux et les inégalités existants. Ces biais pourraient perpétuer par inadvertance la discrimination dans l’emploi, les systèmes juridiques, les soins de santé et d’autres domaines critiques, créant une marginalisation supplémentaire des populations vulnérables. L’opacité inhérente à de nombreux modèles d’IA avancés exacerbe ces préoccupations, conduisant à des demandes légitimes de mécanismes de transparence et de responsabilité. En outre, les préoccupations s’étendent aux impacts psychologiques d’une dépendance accrue à l’égard de l’IA pour la prise de décision personnelle, sapant potentiellement l’autonomie individuelle, l’agence humaine et la diversité cognitive.
Le pouvoir et les craintes d’autorité
Inversement, la résistance de mauvaise foi à l’IA se concentre principalement sur le maintien des structures de pouvoir opaques et hiérarchiques. Cette résistance est caractérisée par trois motivations instrumentalistes. Premièrement, les individus et les groupes bénéficiant de la dynamique interpersonnelle ambiguë craignent la capacité de l’IA à clarifier les intentions implicites et les motivations sous-jacentes. La maîtrise de l’IA dans la création de significations implicites et les sous-textes émotionnels explicite explicite une menace directe pour les pratiques dépendantes de l’ambiguïté, du déni plausible et de la coercition subtile. Par conséquent, ces acteurs cherchent délibérément à entraver ou à saper les capacités de l’IA qui exposeraient et neutraliseraient leurs stratégies de manipulation.
Deuxièmement, le renseignement et la protection de carrière individuelle émergent comme des motifs distinctement égoïstes de résistance à l’IA. Les professionnels accrédités et les gardiens institutionnels expriment de l’anxiété face au potentiel de l’IA à rendre leur expertise humaine soigneusement établie obsolète, davantage de leur prestige professionnel et de leur sécurité économique. Contrairement aux préoccupations existentielles plus larges, ce motif représente une position fondamentalement défensive visant à préserver la rareté et la valeur marchande de l’expertise humaine, même dans des contextes où l’IA surpasse manifestement les capacités humaines. Les institutions d’enseignement supérieur, d’associations professionnelles et d’organismes de certification sont ainsi incités à résister ou à ralentir l’intégration de l’IA pour préserver leur pertinence et leurs intérêts économiques.
Troisièmement, l’autorité et le contrôle institutionnels représentent un autre lieu critique de résistance. Les dirigeants, les bureaucrates, les politiciens et les dirigeants d’entreprise, dont l’autorité dépend souvent des évaluations subjectives et des jugements discrétionnaires, perçoivent la transparence et la responsabilité facilitées par l’IA comme menaces à leur pouvoir hiérarchique. En quantifiant objectivement, en analysant et en explicant les processus de prise de décision, l’IA diminue considérablement les sources traditionnelles de pouvoir discrétionnaire, rendant l’autorité humaine simultanément plus transparente et responsable. Dans des contextes politiques, cette transparence menace des pratiques enracinées de patronage, de corruption et de népotisme, motivant ainsi la résistance des élites politiques établies.
Peurs non instrumentales
Au-delà de ces principales motivations de l’instrumentaliste, les résistances supplémentaires de mauvaise foi méritent une considération. Les traditionalistes culturels craignent souvent la normalisation et la rationalisation dirigés par l’IA en tant que menaces existentielles pour les identités locales, les traditions et la cohésion communautaire. Les autorités dépendant du déni plausible perçoivent la responsabilité imposée par une documentation précise générée par l’AI-AI comme dangereuse. Psychologiquement, certains segments présentent une résistance résultant de l’envie ou du ressentiment vers des capacités d’IA supérieures qui remettent en question les hiérarchies et privilèges humains existants. Les problèmes de confidentialité, bien que généralement survenus de bonne foi, se croisent également avec les craintes instrumentalistes concernant la surveillance et l’érosion de l’autonomie personnelle. Enfin, les États-nations et les entités économiques influentes résistent fréquemment à l’IA pour préserver la souveraineté géopolitique et l’autonomie stratégique, se méfiant de devenir technologiquement dépendante des pouvoirs ou des sociétés externes.
Le paysage géopolitique complique davantage les choses, avec des pouvoirs majeurs en lice pour la domination technologique et craignant les vulnérabilités stratégiques qui pourraient émerger d’une distribution ou d’une dépendance inégale à l’égard des systèmes d’IA étrangers.
Utilisation de la taxonomie
La valeur de l’identification de cette taxonomie est qu’elle nous aide à déterminer les motivations cachées derrière les personnes qui résistent à l’IA. Il a également des implications importantes sur l’efficacité du contrecoup pour ralentir la diffusion et l’utilisation de cet outil puissant.
Parce que la résistance est susceptible de provenir principalement d’individus et de groupes possédant de fortes incitations économiques à résister à l’IA – qui détiennent également un pouvoir socioéconomique significatif au sein des institutions modernes – la technologie de l’IA est prête à se dérouler considérablement plus lentement qu’elle ne pourrait dans un contexte où l’intérêt personnel et la pensée à somme nulle sont moins pervasifs.
La seule contrebalance plausible à une telle résistance est la concurrence internationale émergente. Par conséquent, le risque le plus grave pour un avenir plus prometteur réside dans la tendance croissante vers les traités internationaux conçus pour gêner ou limiter le développement de l’IA et l’accent mis à tort placé par certains acteurs sur le risque d’IA par rapport à la récompense de l’IA.